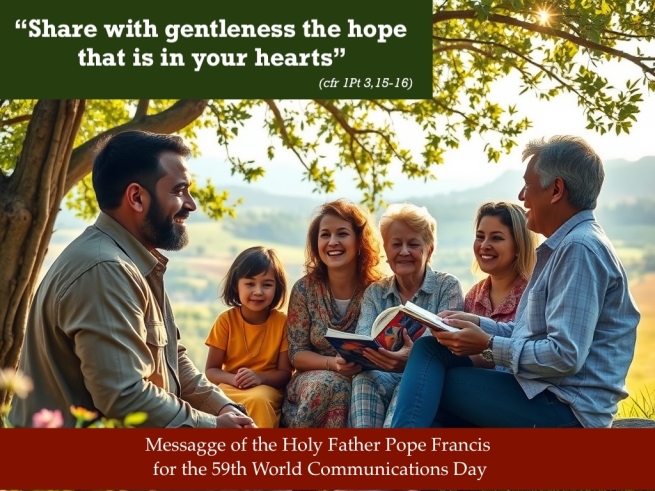Ci-dessous le Message complet du Saint-Père.
Chers frères et sœurs,
en ces temps marqués par la désinformation et la polarisation, où quelques centres de pouvoir contrôlent une masse sans précédent de données et d’informations, je me tourne vers vous en sachant à quel point votre travail de journaliste et de communicateur est nécessaire, aujourd’hui plus que jamais. Nous avons besoin de votre engagement courageux pour mettre au centre de la communication la responsabilité personnelle et collective envers le prochain. En pensant au Jubilé, que nous célébrons cette année comme un temps de grâce dans une époque très troublée, je voudrais vous inviter par ce message à être des communicateurs d’espérance, en commençant par un renouveau de votre travail et de votre mission selon l’esprit de l’Évangile.
Désarmer la communication
Trop souvent aujourd’hui, la communication ne suscite pas d’espérance, mais plutôt la peur et le désespoir, les préjugés et le ressentiment, le fanatisme et même la haine. Trop souvent, elle simplifie la réalité pour provoquer des réactions instinctives ; elle utilise la parole comme une lame ; elle se sert même à dessein d’informations fausses ou déformées pour envoyer des messages destinés à exciter, à provoquer, à blesser. J’ai déjà répété à plusieurs reprises qu’il est nécessaire de “désarmer” la communication, de la purifier de toute agressivité. Réduire la réalité à des slogans ne peut jamais apporter rien de bon. Nous voyons tous comment – à commencer par les débats télévisés aux joutes verbales sur les réseaux sociaux – le paradigme de la concurrence, de l’opposition, de la volonté de dominer et posséder, et de la manipulation de l’opinion publique risque de l’emporter. Il y a aussi un autre phénomène inquiétant : celui que l’on pourrait appeler la “détournement programmé de l’attention” par le biais de systèmes numériques qui, en nous orientant selon les logiques du marché, modifient notre perception de la réalité. Nous assistons ainsi, souvent impuissants, à une sorte d’atomisation des intérêts qui finit par saper les fondements de notre appartenance à une communauté, la capacité de travailler ensemble pour un bien commun, de nous écouter et de comprendre les raisons de l’autre. Il semble donc que l’identification d’un “ennemi” contre lequel se déchaîner verbalement soit indispensable pour s’affirmer. Et quand l’autre devient un “ennemi”, quand son visage et sa dignité sont obscurcis pour se moquer de lui, la possibilité de générer de l’espérance disparaît également. Comme nous l’a enseigné Don Tonino Bello, tous les conflits « trouvent leur racine dans la disparition des visages ».[1] Nous ne pouvons pas accepter cette logique. Espérer, en effet, n’est pas du tout facile. Georges Bernanos disait que « n’espèrent que ceux qui ont le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu’ils prenaient faussement pour de l’espérance. […] L’espérance est un risque à courir, c’est même le risque des risques ».[2] L’espérance est une vertu cachée, tenace et patiente. Cependant, pour les chrétiens, espérer n’est pas un choix facultatif, mais une condition irréductible. Comme l’a rappelé Benoît XVI dans l’encyclique Spe salvi, l’espérance n’est pas un optimisme passif mais, au contraire, une vertu “performative”, capable de changer la vie : « Celui qui a l’espérance vit différemment ; une vie nouvelle lui a déjà été donnée » (n. 2).
Rendre raison avec douceur de l’espérance qui est en nous
Nous trouvons dans la première lettre de Pierre une synthèse admirable dans laquelle l’espérance est mise en relation avec le témoignage et la communication chrétienne : « Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect » (3, 15-16). Je voudrais m’arrêter sur trois messages que nous pouvons tirer de ces paroles. « Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur » : l’espérance des chrétiens a un visage, celui du Seigneur ressuscité. Sa promesse d’être toujours avec nous par le don de l’Esprit Saint nous permet d’espérer même contre toute espérance et de voir les miettes de bien cachées même quand tout semble perdu. Le deuxième message nous demande d’être prêts à rendre raison de l’espérance qui est en nous. Il est intéressant de noter que l’apôtre nous invite à rendre compte de l’espérance « devant quiconque nous demande ». Les chrétiens ne sont pas d’abord ceux qui “parlent” de Dieu, mais ceux qui reflètent la beauté de son amour, une nouvelle façon de vivre toute chose. C’est l’amour vécu qui suscite la question et exige la réponse : pourquoi vivez-vous ainsi ? Pourquoi êtes-vous ainsi ? Dans l’expression de saint Pierre, nous trouvons enfin un troisième message : la réponse à cette question doit être donnée « avec douceur et respect ». La communication des chrétiens - mais je dirais aussi la communication en général - devrait être tissée de douceur, de proximité : le style des compagnons de route, suivant le plus grand Communicateur de tous les temps, Jésus de Nazareth qui dialoguait le long de la route avec les deux disciples d’Emmaüs, faisant brûler leur cœur par la manière dont il interprétait les événements à la lumière des Écritures. C’est pourquoi je rêve d’une communication capable de faire de nous les compagnons de route de nombreux frères etsœurs, de raviver en eux l’espérance en cestempstroublés. Une communication capable de parler au cœur, de susciter non pas des réactions passionnées de fermeture et de colère, mais des attitudes d’ouverture et d’amitié ; capable de mettre en valeur la beauté et l’espérance, même dans les situations apparemment les plus désespérées ; capable de susciter l’engagement, l’empathie, l’intérêt pour les autres. Une communication qui nous aide à « reconnaître la dignité de tout être humain et à prendre soin ensemble de notre maison commune » (Lett. enc. Dilexit nos, n. 217). Je rêve d’une communication qui ne vende pas d’illusions ni de peurs, mais qui soit capable de donner des raisons d’espérer. Martin Luther King a dit : « Si je peux aider quelqu’un en chemin, si je peux réconforter quelqu’un avec un mot ou une chanson... alors ma vie n’aura pas été vécue en vain ».[3] Pour ce faire, nous devons guérir les “maladies” du protagonisme et de l’autoréférentialité, éviter le risque de mal parler les uns des autres : le bon communicateur fait en sorte que ceux qui écoutent, lisent ou regardent puissent prendre part, être proches, trouver le meilleur d’eux-mêmes et entrer avec ces attitudes dans les histoires qui leur sont racontées. Communiquer de cette manière aide à devenir des “pèlerins de l’espérance”, selon la devise du Jubilé.
Espérer ensemble
L’espérance est toujours un projet communautaire. Pensons un instant à la grandeur du message de cette année de grâce : nous sommes tous invités - vraiment tous ! - à recommencer, à laisser Dieu nous relever, à le laisser nous embrasser et nous combler de miséricorde. Les dimensions personnelle et communautaire sont imbriquées dans tout cela. Nous nous mettons en route ensemble, nous faisons le pèlerinage avec de nombreux frères et sœurs, nous franchissons la Porte Sainte ensemble. Le Jubilé a de nombreuses implications sociales. Pensons par exemple au message de miséricorde et d’espérance pour ceux qui vivent dans les prisons, ou encore à l’appel à la proximité et à la tendresse envers ceux qui souffrent et sont en marge de la société. Le Jubilé nous rappelle que ceux qui deviennent des artisans de paix « seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9). Il nous ouvre donc à l’espérance, il nous montre la nécessité d’une communication attentive, douce, réfléchie, capable d’indiquer des voies de dialogue. Je vous encourage donc à découvrir et à raconter les multiples histoires porteuses de bien, cachées dans les plis de l’actualité ; à imiter les chercheurs d’or qui tamisent inlassablement le sable à la recherche de la minuscule pépite. Il est bon de trouver ces semences d’espérance et de les faire connaître. Cela aide le monde à être un peu moins sourd au cri des plus petits, un peu moins indifférent, un peu moins fermé. Sachez toujours trouver les étincelles de bien qui nous permettent d’espérer. Cette communication peut aider à tisser la communion, à nous faire sentir moins seuls, à redécouvrir l’importance de marcher ensemble.
Ne pas oublier le cœur
Chers frères et sœurs, face aux conquêtes vertigineuses de la technologie, je vous invite à prendre soin de votre cœur, c’est-à-dire de votre vie intérieure. Qu’est-ce que cela signifie ? Je vous laisse quelques pistes. Soyez doux et n’oubliez jamaisle visage de l’autre ; parlez au cœur desfemmes et des hommes au service desquels vous faites votre travail. Ne laissez pas les réactions instinctives guider votre communication. Semez toujours l’espérance, même si c’est difficile, même si cela coûte, même si cela semble ne pas porter de fruits. Essayez de pratiquer une communication qui sache guérir les blessures de notre humanité. Faites place à la confiance du cœur qui, comme une fleur fragile mais résistante, résiste aux tempêtes de la vie et s’épanouit dans les endroits les plus inattendus : l’espérance des mères qui prient chaque jour pour voir revenir leurs enfants des tranchées d’un conflit ; l’espérance des pères qui émigrent au milieu de mille risques et vicissitudes à la recherche d’un avenir meilleur ; l’espérance des enfants qui parviennent à jouer, à sourire et à croire en la vie même au milieu des décombres des guerres et dans les rues pauvres des favelas. Soyez les témoins et les promoteurs d’une communication non hostile, diffusant une culture de l’attention, construisant des ponts et transperçant les murs visibles et invisibles de notre époque. Racontez des histoires pleines d’espérance, en prenant à cœur notre destin commun et en écrivant ensemble l’histoire de notre avenir. Tout cela, vous pouvez et nous pouvons le faire avec la grâce de Dieu que le Jubilé nous aide à recevoir en abondance. Je prie pour cela et je bénis chacun d’entre vous ainsi que votre travail.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 24 janvier 2025, Mémoire de saint François de Sales
FRANÇOIS